![[*]](crossref.gif) ]
jusqu'à l'ordre
]
jusqu'à l'ordre
L'équation dynamique des marches est obtenue, à l'ordre dominant, en développant l'équation
[![[*]](crossref.gif) ]
jusqu'à l'ordre
]
jusqu'à l'ordre
![]() .
On fera pour cela usage des lois d'échelle obtenues à partir de l'étude linéaire :
.
On fera pour cela usage des lois d'échelle obtenues à partir de l'étude linéaire :
![]()
![]()
![]() et
et
![]()
![]()
![]() .
.
Nous introduisons ![]() , la perturbation de la position de la marche m, définie par
, la perturbation de la position de la marche m, définie par
![]() = zm - m où zm est la position de la marche m. Pour le déroulement des calculs, nous supposerons que le comportement d'échelle de
= zm - m où zm est la position de la marche m. Pour le déroulement des calculs, nous supposerons que le comportement d'échelle de ![]() est a priori régulier ; c'est-à-dire
est a priori régulier ; c'est-à-dire
![]()
![]()
![]() avec
avec
![]()
![]() 0. Cette hypothèse sera vérifiée de façon consistante par la suite.
En utilisant la définition de l'opérateur
0. Cette hypothèse sera vérifiée de façon consistante par la suite.
En utilisant la définition de l'opérateur ![]() , on a :
, on a :
| = | zm + 1 - zm = 1 + |
(4.48) | |
| = | (4.49) |
| = | fm - fm - 1 = |
||
| = | (4.50) |
En faisant usage de ces relations, le développement de l'équation [![[*]](crossref.gif) ] conduit, à l'ordre dominant, à l'équation dynamique suivante pour
] conduit, à l'ordre dominant, à l'équation dynamique suivante pour ![]() :
:
| = | P  + +  |
||
| - | ![$\displaystyle {\frac{\left[2 \, R \, \nu_+\nu_- \, c_{eq}^0 - P \, \Delta \nu\right]}{2}}$](img771.gif) 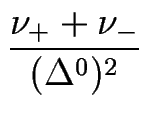 |
||
| - |  |
||
| - |   |
||
| + O(R2, PR, |
(4.51) |
Rappelons que ![]() , la perturbation de la position de la marche m, est une fonction discrète de l'indice m des marches.
Cet indice m est relié à la hauteur h de la surface, en ce sens que la terrasse m est à une hauteur fixée y = - ma, où a est une longueur atomique.
Nous posons Y = - y/a et considérons une fonction
, la perturbation de la position de la marche m, est une fonction discrète de l'indice m des marches.
Cet indice m est relié à la hauteur h de la surface, en ce sens que la terrasse m est à une hauteur fixée y = - ma, où a est une longueur atomique.
Nous posons Y = - y/a et considérons une fonction ![]() de la variable continue Y définie de telle sorte que
de la variable continue Y définie de telle sorte que
![]() (Y = m) =
(Y = m) = ![]() . La courbe définie par
z =
. La courbe définie par
z = ![]() (Y) + Y
(Y) + Y![]() est une approximation continue de la surface vicinale (voir figure [
est une approximation continue de la surface vicinale (voir figure [![[*]](crossref.gif) ]).
]).
| = | |||
| = | (4.52) |
Après quelques manipulations algébriques, l'équation d'évolution
obtenue à partir de [![[*]](crossref.gif) ] prend la forme :
] prend la forme :
Finalement cette dernière équation peut être transformée en une équation d'évolution pour la hauteur h de la surface en inversant la fonction
![]() (y).
Une représentation générale de la surface est donnée par
G(y, z, t) = 0, où y et z sont les coordonnées spatiales.
Dans la représentation discrète de la surface donnée par la position des marches, G s'écrit :
(y).
Une représentation générale de la surface est donnée par
G(y, z, t) = 0, où y et z sont les coordonnées spatiales.
Dans la représentation discrète de la surface donnée par la position des marches, G s'écrit :
| G(y, z, t) | = | z - zm(t) | |
| = | z - Pt - m - |
||
| = | z - Pt - Y - |
(4.54) |
| G(y, z, t) = y/a - h(z, t) , | (4.55) |
| = | - |
(4.57) | |
| 1 + |
= | - |
(4.58) |
| = | (4.59) |
Introduisons
![]() = h + z, qui représente la hauteur de la surface à laquelle la pente moyenne de la surface vicinale a été soustraite.
En prenant en compte le comportement en
= h + z, qui représente la hauteur de la surface à laquelle la pente moyenne de la surface vicinale a été soustraite.
En prenant en compte le comportement en ![]() de h :
de h :
![]()
![]()
![]()
![]() , avec
, avec
![]() d'ordre un, on obtient, à partir de l'équation [
d'ordre un, on obtient, à partir de l'équation [![[*]](crossref.gif) ], l'équation d'évolution non linéaire à l'ordre dominant :
], l'équation d'évolution non linéaire à l'ordre dominant :
![[*]](crossref.gif) ] se réduit à une équation à un seul paramètre :
où
] se réduit à une équation à un seul paramètre :
où ![[*]](crossref.gif) ] :
] :
L'équation [![[*]](crossref.gif) ] est l'équation d'évolution appropriée pour le profil de la surface vicinale dans la limite sans désorption.
Cette équation a été rencontrée récemment par Csahók, Misbah et Valance [#!Csahok00!#] dans le contexte de l'étude de la formation de rides sur le sable sous l'action du vent (nous l'appellerons donc dans
la suite équation CMV).
Elle a une forme de loi de conservation ; c'est-à-dire que la vitesse de croissance de la surface peut s'écrire comme la divergence d'un flux.
] est l'équation d'évolution appropriée pour le profil de la surface vicinale dans la limite sans désorption.
Cette équation a été rencontrée récemment par Csahók, Misbah et Valance [#!Csahok00!#] dans le contexte de l'étude de la formation de rides sur le sable sous l'action du vent (nous l'appellerons donc dans
la suite équation CMV).
Elle a une forme de loi de conservation ; c'est-à-dire que la vitesse de croissance de la surface peut s'écrire comme la divergence d'un flux.
Présentons maintenant les principaux résultats de l'intégration numérique
de l'équation [![[*]](crossref.gif) ].
Contrairement à l'équation de Benney [
].
Contrairement à l'équation de Benney [![[*]](crossref.gif) ], l'équation [
], l'équation [![[*]](crossref.gif) ] donne naissance à un processus de mûrissement (comme cela est visible sur la figure [
] donne naissance à un processus de mûrissement (comme cela est visible sur la figure [![[*]](crossref.gif) ]).
À partir d'une perturbation initiale aléatoire, le profil de la surface développe tout d'abord une structure cellulaire dont la longueur d'onde correspond à celle du mode le plus instable linéairement.
Puis, à mesure que le temps s'écoule, les cellules formées coalescent entre elles, initiant un processus de mûrissement de la structure du profil de la surface.
]).
À partir d'une perturbation initiale aléatoire, le profil de la surface développe tout d'abord une structure cellulaire dont la longueur d'onde correspond à celle du mode le plus instable linéairement.
Puis, à mesure que le temps s'écoule, les cellules formées coalescent entre elles, initiant un processus de mûrissement de la structure du profil de la surface.
Chaque « cellule » correspond à un paquet de marches (voir fig.[![[*]](crossref.gif) ]).
Le processus de mûrissement observé sur la structure du profil de la surface correspond alors pour le train de marches à un appariement des paquets de marches.
]).
Le processus de mûrissement observé sur la structure du profil de la surface correspond alors pour le train de marches à un appariement des paquets de marches.
![\includegraphics[width=12cm,angle=0]{../Images/mail_2.eps}](img878.gif)
|
Après un régime transitoire, la longueur d'onde caractéristique de la structure cellulaire (inversement proportionnelle au nombre de cellules observées par unité de longueur) croît avec le temps (voir figure [![[*]](crossref.gif) -a)]) comme une loi de puissance :
-a)]) comme une loi de puissance :
|
|
(4.63) |
|
![[*]](crossref.gif) ]).
]).
Cette étude, jointe à une précédente [#!Misbah96!#] effectuée dans le cas où la la longueur de diffusion avant désorption
xs = ![]() est finie, donne une vision globale de la dynamique de l'instabilité de mise en paquets des marches sur les surfaces vicinales dans les deux limites extrêmes : celle conservée et celle non conservée.
Ces deux limites correspondent aux cas où
la taille typique des structures mises en jeu sont plus grandes
ou plus petites que xs.
Notre dérivation a l'avantage de lier les coefficients
de l'équation d'évolution macroscopique
aux coefficients physiques du modèle microscopique.
Par exemple, nous avons montré que le préfacteur du terme non linéaire
résulte de la combinaison des interactions élastiques
et de l'électromigration (voir équation [
est finie, donne une vision globale de la dynamique de l'instabilité de mise en paquets des marches sur les surfaces vicinales dans les deux limites extrêmes : celle conservée et celle non conservée.
Ces deux limites correspondent aux cas où
la taille typique des structures mises en jeu sont plus grandes
ou plus petites que xs.
Notre dérivation a l'avantage de lier les coefficients
de l'équation d'évolution macroscopique
aux coefficients physiques du modèle microscopique.
Par exemple, nous avons montré que le préfacteur du terme non linéaire
résulte de la combinaison des interactions élastiques
et de l'électromigration (voir équation [![[*]](crossref.gif) ]).
]).
Un problème cependant se pose. À temps long, nous trouvons que la rugosité du profil de la surface suit une loi de puissance de la forme
w ![]() t1, 5 (voir figure [
t1, 5 (voir figure [![[*]](crossref.gif) -b)]).
En introduisant les exposants de rugosité
-b)]).
En introduisant les exposants de rugosité ![]() et de mûrissement latéral
et de mûrissement latéral ![]() , les solutions self-similaires de
l'équation [
, les solutions self-similaires de
l'équation [![[*]](crossref.gif) ]
peuvent s'écrire sous la forme :
]
peuvent s'écrire sous la forme :
|
| |
(4.65) |
![[*]](crossref.gif) ] nous montrent que
] nous montrent que
![[*]](crossref.gif) ]).
Comme
]).
Comme
Le comportement à temps long de l'équation [![[*]](crossref.gif) ] ne semble pas aller en ce sens.
La pente moyenne
] ne semble pas aller en ce sens.
La pente moyenne
![]() |
|![]()
![]() |
| ![]() continue de croître au cours du temps, sans donner de signe précurseur de saturation.
continue de croître au cours du temps, sans donner de signe précurseur de saturation.
L'équation [![[*]](crossref.gif) ] décrit la dynamique du profil de la surface à l'ordre dominant en
] décrit la dynamique du profil de la surface à l'ordre dominant en ![]() .
C'est-à-dire qu'on y a négligé les termes d'ordre supérieur.
Cependant, à mesure qu'augmente la pente moyenne de la surface, des non-linéarités initialement négligeables peuvent devenir pertinentes dans la description de la dynamique et éventuellement modifier à temps long le comportement dynamique de la surface.
Il devient alors impératif, si l'on veut pouvoir décrire correctement la dynamique à temps long du profil de la surface vicinale, de les prendre en compte.
.
C'est-à-dire qu'on y a négligé les termes d'ordre supérieur.
Cependant, à mesure qu'augmente la pente moyenne de la surface, des non-linéarités initialement négligeables peuvent devenir pertinentes dans la description de la dynamique et éventuellement modifier à temps long le comportement dynamique de la surface.
Il devient alors impératif, si l'on veut pouvoir décrire correctement la dynamique à temps long du profil de la surface vicinale, de les prendre en compte.